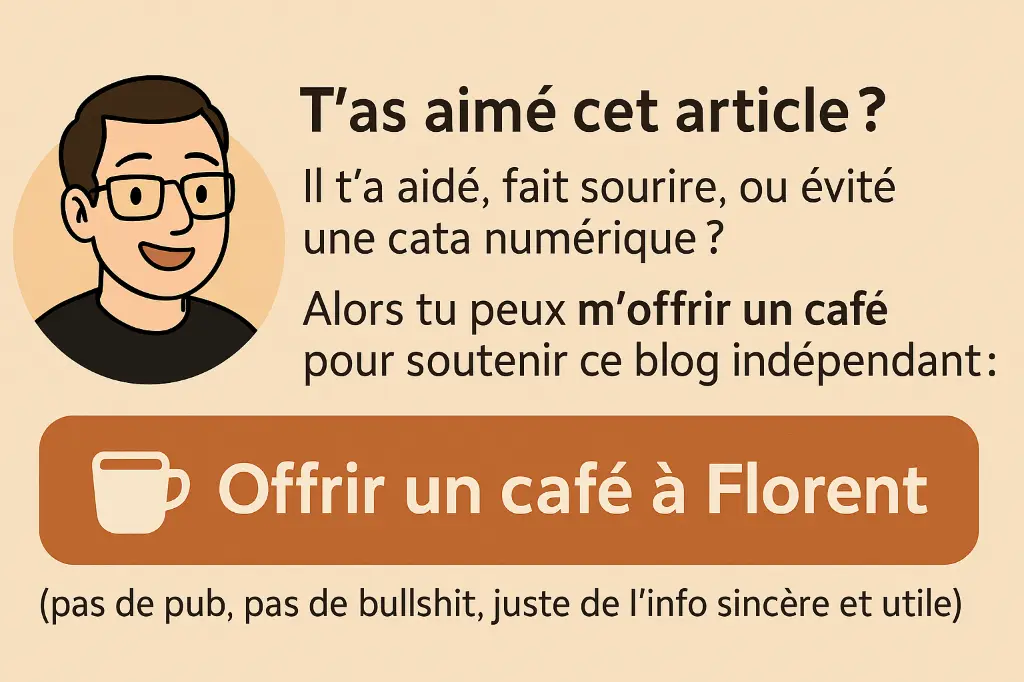Je n’ai pas grandi avec une manette Atari en main, mais j’ai pris le temps de comprendre d’où venait le jeu vidéo.
Pour moi, tout a vraiment commencé avec une PlayStation 1. Il suffisait d’insérer un CD, et d’un coup, un univers entier apparaissait. Pas des pixels ternes, mais une magie que rien ne pouvait gâcher.
Avant ça, sur PC, j’avais connu la 2D un peu rugueuse de quelques vieux titres. C’était sympa, bien sûr. Mais le jour où j’ai lancé Tomb Raider, je n’ai pas vu des polygones maladroits : j’ai vu un monde immense qui s’ouvrait devant moi. C’était une dinguerie.
Ensuite, j’ai découvert la Game Boy, une petite console monochrome qui, malgré ses limites techniques, proposait des jeux pensés pour être complets. Pas de microtransactions, pas de DLC. Un Zelda sur Game Boy, c’était un jeu qui se suffisait à lui-même. Les magazines de l’époque racontaient ces histoires avec passion : chaque sortie était un événement, chaque cartouche valait son prix.
Aujourd’hui, je regarde cette industrie qui m’a tant fait rêver, et je n’arrive plus à retrouver ce sentiment. Le jeu vidéo est devenu une machine, obsédée par les promesses marketing, les cosmétiques hors de prix et les season passes qui amputent les expériences avant même qu’elles sortent.
C’est pour ça que j’ai eu envie d’écrire ce billet. Parce qu’avant, il y avait des câbles branchés à la main et des cartouches à assembler dans des garages. Maintenant, il y a des trailers clinquants et des justifications bancales. Et si, au fond, on n’avait rien appris en 50 ans ?
Et si le vrai crash qui menace ce médium, ce n’était pas un effondrement financier… mais un crash créatif ?
Quand créer un jeu vidéo était un acte d’artisan
A. Les pionniers oubliés
Avant que le jeu vidéo ne devienne cette industrie multimilliardaire, il a fallu quelques rêveurs qui bricolaient des machines dans l’ombre.
Ralph Baer, par exemple, avait plus l’air d’un inventeur que d’un patron de studio. Il fabriquait sa console Magnavox Odyssey avec des câbles qu’il soudait lui-même. Pas de moteur graphique, pas de pipeline 3D, pas d’asset store. Juste de l’ingéniosité.
Les créateurs de la Fairchild Channel F programmaient en assembleur sur des machines dont personne ne savait vraiment comment elles fonctionnaient. Chaque ligne de code était une découverte.
Quand tu regardes les photos d’époque, tu ne vois pas des bureaux design avec 300 écrans. Tu vois des cartons, des plans griffonnés, des circuits ouverts, et des types qui essayaient de fabriquer quelque chose qui n’avait jamais existé.
C’était le Far West technologique. Il fallait tout inventer : les manettes, les cartouches, le langage qui allait parler à la machine.
B. Le contraste avec aujourd’hui
Quand je repense à cette époque, je me dis qu’on vit dans un paradoxe absolu. Aujourd’hui, un gamin qui télécharge Unity peut créer un jeu vidéo complet en quelques semaines. On a accès à des outils tellement puissants qu’ils auraient paru de la science-fiction aux pionniers.
Et pourtant, malgré ces facilités, malgré ces équipes de centaines de personnes, il se dégage de l’industrie un sentiment d’uniformité. On a troqué la curiosité contre l’optimisation. La prise de risque contre le “benchmark concurrentiel”.
Parfois, je me demande si ce n’est pas la modernité elle-même qui a rincé la magie. Si on avait eu Unity à l’époque, peut-être que je serais devenu développeur pro. Enfant, je créais déjà mes mods sur Morrowind, avec l’éditeur de Bethesda. C’était rudimentaire, mais ça suffisait à faire naître une passion. Aujourd’hui, c’est plus simple que jamais de produire un jeu. Mais plus rare que jamais de produire quelque chose qui ressemble à un acte sincère.
Et je me surprends à craindre même un jeu comme GTA VI. Parce que je me dis qu’il finira peut-être noyé dans un océan de microtransactions et de DLC. Depuis quand je suis devenu comme ça ? Depuis quand je suis devenu l’irascible du jeu vidéo ? Alors que j’aimais ça plus que tout.
Peut-être parce que ce qu’on a perdu en câblage artisanal, on l’a aussi perdu en humilité.
La montée du marketing bullshit
A. Le discours officiel
Aujourd’hui, si tu tends un micro à un cadre d’un grand éditeur, tu entendras toujours le même couplet.
“Faire un jeu vidéo est devenu extraordinairement complexe.”
“Les attentes des joueurs sont énormes.”
“Il faut bien monétiser pour garantir la viabilité économique.”
Ça sonne comme un discours d’entreprise, rodé à la virgule près. Le storytelling est toujours le même : “Nous faisons de notre mieux, mais c’est difficile.” Et à les écouter, on devrait presque s’excuser d’avoir envie d’un jeu fini, stable et complet.
Je ne nie pas que produire un AAA, c’est un défi colossal. Je ne nie pas qu’il y a du talent dans ces studios. Mais la réalité, c’est qu’ils préfèrent souvent se cacher derrière cette complexité pour justifier ce qui n’est pas justifiable :
- Des jeux amputés dès leur conception pour vendre des morceaux plus tard.
- Des fonctionnalités annoncées en fanfare qui disparaissent mystérieusement à la sortie.
- Des budgets marketing qui dépassent parfois le coût de développement, comme si la priorité était d’envahir YouTube plutôt que de polir le produit.
C’est une inflation de promesses non tenues qui fatigue tout le monde.
B. La réalité
La réalité, c’est qu’en 2024, tu peux payer 80 euros pour un AAA vide, instable, et conçu autour des microtransactions. Parfois, on a même le sentiment que le jeu n’est qu’un prétexte : un écran joli destiné à te pousser vers la boutique intégrée. Tu paies plein tarif, et ensuite tu découvres que tout est pensé pour te vendre des cosmétiques, des boosts d’expérience, ou des season passes à rallonge.
Le pire, c’est que ça ne choque presque plus personne. On est devenu tellement habitués qu’on finit par se convaincre que c’est normal. Mais quand tu prends du recul, tu vois bien qu’il y a un problème. Un jeu vendu 80 ou 90 euros devrait pouvoir exister par lui-même, sans dépendre d’un magasin virtuel greffé dessus.
Pendant ce temps, la lassitude grandit. Même ceux qui n’osaient pas le dire commencent à le ressentir. Les forums sont remplis de messages de joueurs qui n’ont plus envie de précommander, plus envie de se faire avoir encore une fois. Parce qu’à force, l’usure finit par tuer la passion.
Et c’est peut-être ça, le vrai drame : pas seulement l’argent gaspillé, mais l’enthousiasme qu’on nous vole, année après année.
Le contraste flagrant avec les indépendants
C’est peut-être dans la scène indépendante que j’ai compris que je n’avais pas vraiment changé. Que je restais toujours ce même gamin qui pouvait s’extasier devant les pixels assez moches d’une Game Boy Color, tant que le jeu avait quelque chose d’authentique à me dire.
La scène indé, c’est un retour aux sources. C’est le rappel que le jeu vidéo n’est pas obligé de ressembler à une vitrine technologique ou à un casino numérique. Il peut juste être un projet sincère, fait par des gens qui aiment profondément ce qu’ils font.
Undertale en est le symbole parfait. Techniquement, c’est un jeu minimaliste, presque grossier si on le juge avec les critères graphiques d’aujourd’hui. Mais quand j’ai lancé la route Génocide, je me suis pris une claque que je n’oublierai jamais. Ce jeu m’a parlé, m’a fait ressentir le poids de mes choix, et a prouvé qu’un scénario pouvait être plus marquant qu’une cinématique en 4K.
Pareil avec Stardew Valley. Eric Barone n’était pas un développeur AAA. Il n’avait pas de budget marketing, pas d’éditeur géant derrière lui. Il avait juste une idée et la passion de la concrétiser. Résultat : un jeu qui a trouvé son public, sans matraquage publicitaire, simplement parce qu’il est vrai.
Et ce sont loin d’être des exceptions. Des perles comme Kynseed existent. Des titres créés par une poignée de passionnés, qui proposent une expérience plus profonde, plus honnête, que bien des blockbusters qui s’imaginent intouchables. La différence ? Ces jeux ne te prennent pas pour un portefeuille sur pattes.
C’est encore plus flagrant quand tu regardes le rapport qualité-prix. Hollow Knight, vendu 15 euros, surclasse sans difficulté des AAA vendus 80 ou 90 euros. Pas besoin de season pass. Pas besoin de microtransactions. Juste un jeu complet, pensé pour être exploré de A à Z.
Et il y a aussi des exemples de jeux récents techniquement ambitieux, mais qui ne se sont pas perdus dans le cynisme. Claire Obscure: Expédition 33 en est une démonstration. Fait par des anciens d’Ubisoft, vendu moins de 50 euros, sans boutique virtuelle greffée. Un gameplay aux petits oignons, un univers pensé pour te divertir, pas pour t’extorquer. Ça devrait être la norme, mais aujourd’hui c’est presque un acte de résistance.
Je peux encore m’émerveiller devant des polygones ultra détaillés. Mais je peux tout autant m’émerveiller devant un RPG en pixel art. Parce qu’au fond, les graphismes ne font pas tout. Et ça, j’ai l’impression que beaucoup d’éditeurs AAA l’ont oublié.
Ils s’appuient sur des licences rincées, comme Call of Duty, qui recyclent la même formule année après année, avec des microtransactions toujours plus agressives et la promesse absurde d’y greffer des NFT ou d’autres gadgets marketing. Mais la sincérité, elle, n’a pas de prix. Et c’est elle qui donne aux jeux leur vraie valeur.
Vers un crash ?
A. Le modèle AAA au bord de l’implosion
Quand on regarde l’industrie AAA aujourd’hui, on a parfois l’impression de contempler un colosse au pied d’argile. D’un côté, des budgets colossaux qui dépassent les 200 ou 300 millions. Des campagnes marketing qui envahissent chaque recoin d’Internet. Des trailers calibrés pour faire saliver.
Et puis, la réalité. Des seuils de rentabilité devenus délirants. Une dépendance totale à la hype et aux précommandes. Et derrière les paillettes, des échecs commerciaux de plus en plus fréquents.
Battlefield 2042 a été un exemple frappant. Un jeu vendu comme une révolution, qui a déboulé avec une pluie de bugs, des fonctionnalités manquantes, et une déception générale. Ou plus récemment, Concord, dont les serveurs ont fermé à une vitesse hallucinante, preuve qu’un budget marketing ne suffit pas à créer l’envie.
Ce qui me frappe, c’est que ces échecs sont presque toujours les mêmes : on essaye de correspondre à des standards, de cocher des cases, de plaire à tout le monde… et on finit par proposer des expériences sans saveur.
Les développeurs, eux, se retrouvent broyés dans cette machine infernale, après avoir donné des années de leur vie à un projet qui sera démoli en une semaine sur les réseaux. Ce n’est pas juste pour eux. Mais c’est le prix de cette fuite en avant.
B. Le crash créatif plus que financier
Ce qui est en train de se passer ressemble à un crash. Mais pas forcément un crash financier immédiat. Les AAA vendent encore. Ils s’écoulent par millions, parfois. Mais ils se vident de leur sens, et la confiance s’effondre.
Moi, je le ressens très fort. Les AAA ne me hypent plus. Quand un gros jeu est annoncé, je ne me dis pas “j’ai hâte”. Je me dis “combien de DLC ? combien de microtransactions ? combien de patchs pour rendre le jeu jouable ?”
C’est un basculement presque imperceptible, mais profond. Quand je lis la presse spécialisée, ce n’est pas vers le prochain Red Dead Redemption ou le nouveau Call of Duty que mes yeux se tournent. C’est vers les projets indépendants, les petites équipes qui ont encore envie de raconter quelque chose.
Et je ne pense pas être le seul. Je crois qu’on est de plus en plus nombreux à ressentir cette méfiance, cette lassitude, cette absence d’enthousiasme. Le AAA, malgré ses millions de copies vendues, ressemble de plus en plus à une bulle qui se vide de sa substance avant de se vider de son argent.
Parce qu’au fond, face à la créativité, ce n’est pas le budget qui prime. C’est l’envie de faire un jeu qui compte.
Et après ?
A. Le futur appartient-il aux indés ?
Quand on regarde l’état de l’industrie AAA, on pourrait croire que tout est foutu. Mais je ne le pense pas. Je crois que le futur appartient à ceux qui n’ont pas oublié pourquoi on fait des jeux vidéo.
L’essor des plateformes décentralisées comme Steam, Itch.io, GOG ou même les services de financement participatif a donné une voix à des créateurs qu’on n’aurait jamais entendus avant. Des développeurs qui n’ont pas besoin d’un département marketing de 500 personnes pour exister. Qui n’ont pas besoin d’un season pass pour prouver qu’ils valent quelque chose.
Ce sont ces gens-là qui redonnent au jeu vidéo son essence : créer des expériences sincères. Proposer une histoire, un univers, une mécanique de gameplay qui les passionne. Pas parce que c’est rentable. Pas parce que ça coche toutes les cases d’un tableau Excel. Mais simplement parce que ça les anime.
Et ça, c’est peut-être la meilleure nouvelle qu’on pouvait espérer. Parce qu’au fond, le jeu vidéo est un art. Un moyen de partager une vision, une envie, une émotion. Pas un simple produit calibré pour extraire toujours plus d’argent.
B. Ce que les joueurs peuvent faire
Si on veut que cette vision survive, il faut aussi que les joueurs fassent un pas. Qu’ils osent lever les yeux des blockbusters qui saturent les timelines et les magasins. Qu’ils prennent le temps de chercher, d’explorer, de donner leur confiance à des projets plus modestes, mais plus vrais.
Parce qu’au fond, chaque euro dépensé est un vote. Chaque achat est une manière de dire : “Je crois en ça.”
Donner de la valeur à la passion plutôt qu’à la publicité, c’est peut-être la seule façon de préserver ce qu’il reste d’authenticité. C’est refuser de se laisser définir par des trailers en CGI et des promesses creuses.
Le jeu vidéo n’a pas besoin d’être une industrie cynique. Il n’a pas besoin de nous convaincre que la seule chose qui compte, c’est la rentabilité. Il peut redevenir ce qu’il a toujours été : une envie de faire s’amuser des gens sur un écran.
Et ça, ça n’a pas de prix.
Conclusion
Le jeu vidéo est devenu un univers immense, saturé de codes marketing, d’arguments de vente, de promesses toujours plus clinquantes. Mais derrière les pixels 4K, derrière les millions engloutis en publicité, il y a quelque chose qui s’est égaré en route.
Ce quelque chose, c’est la passion simple de créer un jeu. Pas un produit. Pas un prétexte à microtransactions. Un jeu. Avec tout ce que ce mot signifie : le plaisir, la curiosité, l’envie d’offrir une expérience qu’on n’oubliera pas.
Je n’ai rien contre le progrès technologique. Ni contre le fait de vendre son travail. Mais quand tout est devenu un modèle d’optimisation, un tableau Excel géant où la créativité passe après la rentabilité, il faut bien se poser la question : est-ce encore ce médium que j’aimais ?
Peut-être qu’on assiste à un crash. Pas seulement un crash financier, mais un crash créatif. Un effondrement lent et silencieux de la confiance qu’on pouvait encore avoir dans ces grands studios qui nous prenaient autrefois pour des joueurs, pas pour des clients captifs.
Pourtant, tout n’est pas perdu. Parce qu’au fond, il suffira toujours d’une petite équipe passionnée, d’un créateur un peu fou, pour rallumer cette étincelle. Il suffira toujours d’un jeu honnête, pensé avec le cœur, pour rappeler à tous ce que le jeu vidéo peut être.
Peut-être que c’est ça, le vrai avenir. Pas la fuite en avant, pas la surenchère, pas le cynisme. Mais un retour à quelque chose de plus simple, de plus sincère. À la volonté de faire, d’abord, un bon jeu. Et ensuite seulement, d’en faire un succès.
Je suis encore cet enfant qui mettait un CD PlayStation et qui croyait que tout était possible. Je suis toujours ce joueur qui veut croire qu’on peut faire mieux. Que le jeu vidéo mérite plus que ce qu’on essaie de lui faire devenir.
Et si vous pensez la même chose, alors peut-être que ce crash ne sera pas une fin. Peut-être que ce sera un nouveau départ.